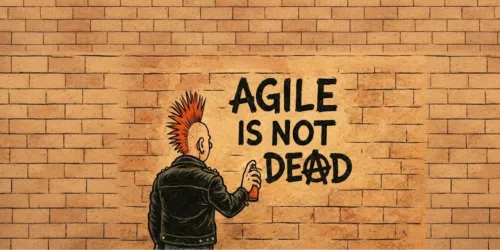Événements
13 minutes de lecture
Le 02/10/2025
Paris Web 2025 : inclusion, accessibilité et futur de nos métiers tech
Chaque automne, Paris Web rassemble des professionnel·les du numérique autour d’un même engagement : penser et concevoir des technologies accessibles, inclusives et durables. Cette année encore, les conférences ont offert un panorama riche, entre retours d’expérience concrets, regards critiques et pistes d’avenir.
En tant que designer stratégique et chercheuse en UX, j’ai suivi plusieurs interventions qui m’ont profondément marquée. Voici les apprentissages clés que j’en retiens pour nos métiers.
L’accessibilité passe aussi par la pédagogie
Mon coup de cœur du jeudi a été la conférence de Cindy Quai, formatrice sourde en design UX et design thinking, responsable pédagogique et engagée pour une formation accessible aux métiers du numérique.
C’était la première fois que j’assistais à une conférence donnée directement en langue des signes, déjà en soi une démonstration d’inclusion. Mais surtout, son message était limpide : la formation telle qu’elle est pensée aujourd’hui exige un effort cognitif immense des personnes sourdes… et au-delà, de toutes celles et ceux qui ne se retrouvent pas dans des modèles d’apprentissage très théoriques.
Elle a montré l’importance de méthodes alternatives : pédagogie inversée, pratique avant la théorie, supports visuels, LSF, FALC, scaffolding. Ces approches ne sont pas seulement utiles aux personnes sourdes ou neurodivergentes : elles bénéficient à tout le monde.
Une pédagogie accessible, c’est une pédagogie plus juste et plus efficace pour l’ensemble des apprenant·es.
La conférence de Cindy Quai rappelle que rendre une formation accessible ne consiste pas à créer un “parallèle” pour un petit groupe, mais à transformer la manière même dont on conçoit l’apprentissage.
Les dispositifs comme la pédagogie inversée (pratique avant théorie), le scaffolding (apprentissage guidé pas à pas), l’usage de la langue des signes, du langage clair ou du FALC (Facile à Lire et à Comprendre) ne sont pas des concessions : ce sont des approches qui facilitent la compréhension pour tout le monde.
- Pour une personne sourde, cela supprime des obstacles évidents.
- Pour une personne neurodivergente, cela réduit l’effort cognitif et évite la surcharge.
- Pour celles et ceux qui apprennent mieux par la pratique (et elles sont nombreuses), cela rend le contenu plus concret et engageant.
- Même pour les profils plus “classiques”, cela permet de retenir plus vite, plus durablement.
Loin d’être une “contrainte”, l’accessibilité devient un levier pédagogique universel. En repensant la manière de transmettre, on ne rend pas seulement la formation plus équitable : on la rend aussi plus efficace, plus inclusive et plus motivante.
L’exclusion n’est pas un bug, mais un système
Le vendredi, c’est la conférence sur le design validiste qui a résonné particulièrement fort pour moi de Tamara Sredojevic.
L’intervenante a montré que l’exclusion n’est pas le résultat d’un oubli ou d’une erreur isolée. Elle est le produit d’un système plus large : celui du validisme, du productivisme, de la hiérarchisation implicite de certains corps et de certains besoins sur d’autres.
Pourquoi faut-il encore justifier l’accessibilité, quand d’autres disciplines ou exigences (performance, sécurité, rentabilité) ne sont jamais questionnées ? Ce décalage met en lumière un biais profond : on considère encore trop souvent l’accessibilité comme un “bonus”, une option que l’on ajouterait en fin de parcours, plutôt qu’une responsabilité systémique et collective.
Penser inclusif ne relève pas d’un geste individuel mais d’un projet collectif de société.
La conférence sur le design validiste a montré avec force que l’exclusion n’est pas la conséquence d’un oubli ponctuel. Elle est produite par un système entier : nos normes, nos priorités, nos façons de hiérarchiser les besoins.
Trop souvent, on réduit l’inclusion à des “bons gestes” : ajouter une option d’accessibilité, proposer un mode sombre, insérer des sous-titres. Ces actions sont utiles, mais elles donnent l’illusion que l’inclusion repose sur des décisions individuelles, isolées, presque “cosmétiques”.
En réalité, l’exclusion est systémique :
- Elle se construit dans les processus (quels besoins on priorise ou on écarte),
- Dans les structures (qui a les moyens ou le droit de participer à la conception),
- Dans les valeurs implicites (productivité avant santé, vitesse avant compréhension, norme avant diversité).
C’est pourquoi penser inclusif ne peut pas être la responsabilité d’une seule personne ou d’une seule équipe. C’est un projet collectif de société : designers, développeurs, managers, décideurs, institutions. Une chaîne entière qui doit accepter de bouger ses repères et de remettre en cause ses habitudes.
L’inclusion, ce n’est donc pas un “plus” que l’on ajoute à un service, mais une transformation profonde de la manière dont on conçoit, organise et gouverne le numérique.

La conférence de Tamara Sredojevic.
L’IA interroge le sens de nos métiers
Enfin, la mini-conférence de Raphaël Yharrassarry sur l’impact psychosocial de l’IA a posé des questions essentielles pour notre avenir professionnel.
Les études restent rares, mais les premiers constats sont préoccupants : perte d’expertise, surconfiance dans les outils, consentement inexistant (l’IA s’impose souvent par défaut dans nos environnements de travail). Plus encore, le risque est de voir disparaître peu à peu la co-construction, l’apprentissage par l’expérience et le lien social au sein des équipes.
L’IA doit rester au service de l’humain, et non l’inverse.
La conférence sur l’impact psychosocial de l’IA a mis en évidence un risque majeur : celui de laisser les machines dicter non seulement nos outils, mais aussi notre manière de travailler, de collaborer, d’apprendre.
Déjà aujourd’hui, l’IA s’invite dans nos environnements sans réel consentement. Elle évalue des CV, organise des backlogs, attribue des tâches, mesure notre temps de travail. Derrière ces automatismes, il y a un danger : que nous devenions assistés par défaut, en perdant peu à peu le contrôle sur nos choix et nos priorités.
Les conséquences vont bien au-delà de la technique :
- une perte d’expertise quand les jeunes professionnels s’appuient sur l’IA plutôt que sur l’expérience collective ;
- une fatigue cognitive liée aux décisions accélérées et au rythme imposé par les outils ;
- une fragilisation du collectif : moins de collaboration, moins d’échanges, moins de sens partagé dans le travail ;
- une illusion de productivité qui masque une réalité plus inquiétante : la médiocrité “by design”.
Utilisée avec discernement, l’IA peut évidemment être un atout. Elle est précieuse pour automatiser des tâches répétitives, chronophages, ou pour analyser rapidement de grands volumes de données. Mais il faut garder une règle simple : les décisions qui engagent l’humain doivent rester humaines.
Autrement dit, l’IA doit rester un outil, un support, un accélérateur… mais jamais un pilote. C’est à nous de définir ses usages, de les encadrer et de préserver ce qui fait la valeur de nos métiers : la créativité, l’éthique, le lien social, l’intelligence collective.
D’autres fils rouges de Paris Web
Au-delà de ces trois conférences marquantes, plusieurs interventions ont esquissé un même horizon : celui d’un numérique qui doit être à la fois accessible, sobre et réellement conçu avec les personnes concernées.
Fracture numérique : penser un web accessible même sans connexion stable
L’intervention d’Ignacio Rondini a rappelé une réalité trop souvent oubliée : l’accès à Internet n’est ni universel ni garanti. Dans de nombreuses zones rurales, au Chili mais aussi en Europe, les connexions sont instables, les appareils limités, parfois même l’électricité n’est pas disponible en continu. Concevoir des services “comme si” tout le monde disposait d’un réseau illimité et d’outils récents, c’est déjà exclure une partie des usagers.
Cela invite à explorer des solutions low tech : permettre un usage hors ligne, optimiser les performances, adapter les services aux environnements contraints. Non seulement pour l’inclusion, mais aussi pour la résilience en cas de coupures ou de crises.
Accessibilité et écoconception : convergence des enjeux
Un autre retour d’expérience, autour du RGESN, a montré comment l’accessibilité et la sobriété numérique pouvaient se renforcer mutuellement. En travaillant collectivement – designers, développeurs, contributeurs, hébergeurs – il est possible de viser à la fois la conformité réglementaire et la réduction de l’impact environnemental.
Il ne s’agit pas de deux démarches séparées mais bien de dynamiques convergentes. Rendre un service accessible, c’est aussi souvent le rendre plus léger, plus performant, et donc plus durable.
Recherche utilisatrice inclusive : dépasser les normes
Enfin, la conférence de Justine Nicol a mis en évidence les limites d’une approche centrée uniquement sur les standards (RGAA, WCAG). Les normes sont indispensables, mais elles ne suffisent pas à garantir une expérience réellement inclusive. Pour cela, il faut impliquer directement les personnes concernées : tester avec elles, écouter leurs usages réels, comprendre leurs difficultés quotidiennes.
Autrement dit, l’accessibilité ne peut pas être réduite à une checklist : elle doit s’ancrer dans une démarche d’écoute et de co-conception avec les usagers.
Ce que Paris Web nous rappelle
Ces interventions rappellent une évidence : l’inclusion n’est pas un supplément d’âme, mais une condition de sens pour nos métiers.
Accessibilité, sobriété et regard critique sur l’IA ne sont pas des démarches séparées. Ensemble, elles tracent la voie d’un numérique capable de servir toutes les personnes, et non d’en exclure certaines par défaut.
Chez NEXTON, nous sommes convaincus que ces réflexions doivent irriguer nos pratiques au quotidien. Parce que penser inclusif, ce n’est pas seulement élargir son audience : c’est concevoir autrement, dès le départ, pour que personne ne soit laissé de côté.
Luz DELGADO BAUTISTA, Designer Stratégique